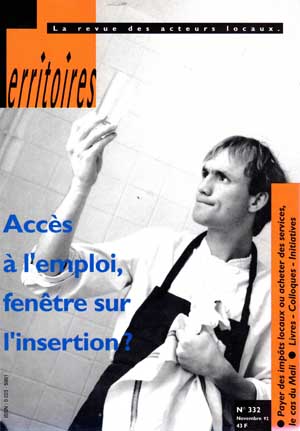Parcours d’insertion : les leçons de l’expérience
M’étant trouvée, dans le cadre de mon cabinet-conseil, dans la situation d’accompagner des encadrants (travailleurs sociaux, agents de structures d’insertion ou de missions locales, chefs de projets ville, formateurs) sur la question des parcours d’insertion, j’ai mis au point une méthode intitulée « les 9 marches » qui puisse s’affranchir des procédures habituelles et cesser de modifier le rang des personnes en attente, sans améliorer le taux de réussite global.
Cette méthode s’appuie sur quelques principes :
- le classement des publics par indices de gravité et par catégories administratives ou par types de mesure fonctionne très mal ;
- on ne mobilise pas sur des manques et des problèmes ; on mobilise sur des ressources ;
- les personnes exclues n’ont jamais « zéro ressources » et quel que soit le degré d’exclusion, on ne passe jamais du « rien » au « tout » dans un parcours ;
- le parcours n’est pas linéaire, mais hiérarchique et cumulatif. Il y a certaines cartes maîtresses dans le jeu de chaque personne dont l’absence bloque l’accès à d’autres ressources : en agissant sur ces points-clés, on réactive des ressources occultées sans avoir à les combler.
- Un tiers des personnes est dans des systèmes récurrents de type « Sisyphe » et a internalisé leur exclusion : elles ne sont pas « déstructurées », mais « a-structurées » et nécessitent un accompagnement spécifique long diamétralement opposé aux autres publics.
Trois pôles, neuf familles de ressources
La méthode a consisté à « aller voir chez les inclus » le comportement des personnes insérées, afin de donner aux exclus ce qu’il y avait de meilleur. Elle s’est appuyée sur l’analyse de 214 candidats à la création d’entreprises « particulièrement armés », qui cumulaient les conditions favorables pour réussir (projet identifié, créneau porteur, carnet d’adresses, soutien familial, ressources financières, compétences et qualification…) Sur ce panel suivi pendant un an, plus de la moitié (« les velléitaires ») abandonnait au stade du projet. Seuls 6% du total passaient directement du désir à l’action. Si des personnes particulièrement armées étaient incapables de passer directement du désir à l’action, il était absurde de le réclamer a fortiori à des personnes en difficulté. Par ailleurs, un tiers abandonnaient leur projet à ce stade. J’ai donc étudié comment les 44% restants s’y prenaient pour poursuivre la démarche, qui avait pour point commun d’avoir tous un projet identifié (« J’ai envie de »), ayant activé ce que j’ai appelé le pôle du désir.
Un certain nombre développait ce que j’ai intitulé le pôle des compétences afin de peaufiner leur projet (« je suis capable », « je me sécurise »). 6% ont abandonné après avoir fait le point sur leurs compétences, ce qui est peu et monte l’importance du facteur « motivation » par rapport à celui des capacités. Mais aucun porteur de projet n’est passé directement à l’action ensuite. Les candidats marquaient un temps d’arrêt dont j’ai essayé de déterminer les causes.
Une première catégorie déclare : « ce n’est pas mon vrai désir ». 6% repartent dans ce pôle, reformulent leur projet, en construisent un autre, ou sortent du système ( autre type d’emploi ).
Les autres disent : « je ne suis pas prêt »… Comme si un obstacle de l’ordre du rapport à soi-même et aux autres barrait la route. C’est ce que j’ai appelé le pôle de la conscience. Certains ont recommencé l’ensemble du parcours jusqu’à 3 reprises. 15% sont passés à l’acte dans l’année qui a suivi.
En approfondissant un peu plus les ressources mobilisées à chaque phase, j’ai pu identifier dans chaque pôle 3 items : d’où le nom de la méthode : 9 familles de ressources, 9 « marches » classées par ordre d’importance (et non par chronologie) regroupées en 3 pôles avec des paliers de I à III séparant les volées de marches.
J’ai décrit ces 9 étapes dans un article paru en 1994 dans la revue Territoires, puis dans un chapitre d’un livre collectif « La commune et l’insertion par l’économique » paru en 1996, rapidement épuisé.
Une déclinaison à six faces
Cette méthode a été mise en place dans une dizaine de sites, sur un échantillon d’environ 2500 personnes, représentant une large palette de cas, notamment Tourcoing ( Plan Tourquennois d’Insertion), agglomération d’Evry (Plan Delta), Lizy dans l’Aisne (Centre pour adolescents en protection judiciaire), agglomération de Cherbourg (Maison de l’Emploi), Cergy-Pontoise (Association d’Insertion ALICE), le bassin de Meaux (Mission locale), Argenteuil (Grand Projet Urbain du Val d’Argent – 50 000 h en ZFU).
Diagnostic de la demande
Les principes de la méthode sont à chaque fois présentés aux accompagnateurs qui établissent ensuite leur propre grille de lecture et construisent au cours d’entretiens un diagnostic de demande individuelle -négocié avec chaque personne- sur ses principales ressources et manques. Ces questionnaires s’additionnent et permettent d’établir un profil collectif de ressources et de besoins, un diagnostic de la demande collective pour un groupe ou une structure. On peut aussi définir la demande globale pour les publics d’un site donné, afin d’établir un diagnostic de la demande du territoire. Tous ces diagnostics évoluent dans le temps et s’enrichissent au fur et à mesure de la progression de l’accompagnement et de la mise en place des réponses.
Diagnostic de l’offre
En face, il est possible de déterminer une offre de parcours pour une personne, un collectif (groupe ou structure) et/ou un territoire. La déclinaison en marches par personne/ par structure/ par territoire permet de voir immédiatement par comparaison offre/demande les obstacles aux parcours et les besoins les plus urgents et les plus nombreux à combler. Et ainsi de mettre en place en face du diagnostic de la demande, des offres manquantes au niveau le plus pertinent (personne, structure, territoire) et avec des ordres de priorité.
Pour compléter : un article paru dans Territoires de Nov 1992 malheureusement ancien.
Livre collectif « La commune et l’insertion par l’économique », 1996 (épuisé).
A disposition : de nombreuses études de cas pratiques individuels et collectifs.
Littérature grise : 2400 pages de rapports d’études et d’outils de formation fabriqués sur mesure par J. LORTHIOIS
Manuscrit : un projet de livre dont la publication a été ajournée pour raison de santé.